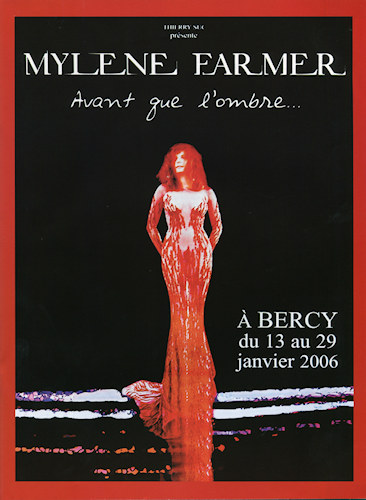Au risque d’un
peu trop décortiquer la crevette (^^), une
interprétation de l’album Interstellaires parmi
mille autres, personnelle, rien de prescriptif.
La robe de nuages de Mylène derrière un soleil
d’aurore annonce un changement radical, une nouvelle
ère portée par une lune de neiges, un brouillard
astral, un lait d’étoiles, un soleil levant sur
une planète noire. Pochette et photos du livret
créent d’emblée une
atmosphère.
Interstellaires
est un précipité de l’album. Les
ressources de la Terre sont épuisées,
d’où le rêve d’un nouveau
départ, de reconstruire un « monde
meilleur » et la quête d’un
autre monde pour échapper à une terre devenue
inhabitable. Echec, échec : le voyage
débouche sur un trou noir de
« nébuleuses
obscures ». L’homme risque un voyage dans
l’immensité de l’espace, du divin (voir
les chœurs), sublime mais dangereuse à son
échelle. Est-il capable d’y vivre autrement que
sous une autre forme,
« diffuse », état
ultérieur de l’Evolution tel que le montre Stanley
Kubrick à la fin de 2001 l’Odyssée de
l’espace ? « Si
c’était moi », je n’y
serais pas allée, mais j’ai accepté
« pour nos rêves ». Et
maintenant je manque d’air, d’oxygène
cf. la répétition de
« -laires » à la fin
de la chanson.
Stolen Mad Max euh…
Stolen
car : un monde terrestre aux
températures devenues insupportables, un désert,
tard dans la nuit, un homme errant vole une voiture
abandonnée. Il vit de trafics de
« wires » qui permettent
l’allumage de voitures abandonnées et
l’espoir d’un exil hors de cet enfer. Le rapport
avec ce nouvel abri est charnel. Il éveille le fantasme
d’une autre vie, rêvée ou
vécue jadis, de mots d’amour, de famille, de
sensations érotiques, de fuite à deux. Danse du
rêve ou de la voiture en fuite, cette promesse
d’une spiritualité perdue tranche avec
l’insécurité du réel
où « chasseur »
et « proie »
s’affrontent.
A rebours
aurait-il un lien avec le roman du même nom de
Huysmans ? Le personnage principal se préserve des
dérives du monde en s’enfermant physiquement
(« barreaux »
« croix ») et surtout mentalement
(« comme un sourd muet ») et en
s’entourant des seules marques d’un
passé révolu considéré
comme plus épanouissant. Des objets, des livres pour les
étudier :
« epsilon »
« questionnant l’infini, fermant porte
à l’oubli ». Le risque est de
s’autodétruire en s’isolant dans un
monde
factice : « le réel se
dérobe » et nous rattrape,
« les fantômes ne nous laissent en
paix ». Le monde a été
créé pour qu’on y évolue,
qu’on s’y rencontre, qu’on y trouve
l’amour, le seul vrai moteur,
« à portée
d’aimer », « gagner les
cimes ». « En un tour de
clé », on peut choisir
l’angoisse de la réclusion
(« tyrannie des secrets
gardés ») ou au contraire
s’ouvrir au monde.
Une vie sans amour ?
C’est pas moi … Allégresse
de vivre et joies de l’amour associées aux joies
de la création et de l’art (musique
« ritournelle », dessin et
écriture « crayon »,
« danse »). Variation du mythe
platonicien, on se sent incomplet (« comme un crayon
sans mine »), inerte, insignifiant
(« un bout de bois ») sans sa
moitié, sans l’autre qui est une part de soi.
L’être aimé est un refuge
« asile », une nourriture (et son
absence, une « indicible
famine »). Il est une oreille et une voix
(« son »). Il donne du
goût à la vie
(« sel »). Il donne envie de
faire corps avec la nature (« danser sur une
grève »). Il ouvre sur le monde
(« pont ») à travers
le désir de l’aimé(e). Il redonne vie
aux martyres devenus constellations qui nous regardent depuis
l’espace (« sanglants du ciel,
éclairez-moi »). Il éveille en
soi le meilleur
(« sève »), quitte
à risquer un chemin difficile pour le trouver
(« la vie mais que vaut-elle sans danger sans
choix »). Mais cela vaut mieux que, comme beaucoup,
nier son identité et sa liberté
(« marcher sa vie entière à
côté de soi, tant d’âmes se
méprennent ») en agissant selon un dogme
d’idées reçues (« un
oui, un non, une ligne droite »). Mais
n’est-ce qu’un rêve
d’amour ? « J’ose, le
songe est digne »… Il demeure
nécessaire…
A l’aérien Interstellaires répond
l’impénétrable
Insondables, qui
clôt pour les nostalgiques une hypothétique face A
de vieux vinyle grésillant. Quelques échos qui
sait de Désenchantée :
« plus rien
n’enchante »,
« chaos ». Sans doute une obscure
dérive de ma part mais y a-t-il un lien avec le roman
L’invention de Morel d’Adolfo Bioy Casares qui met
en scène des ombres insaisissables et résolument
muettes ? L’être humain ne fait plus corps avec la
nature : « insondables
flots/vents ». L’amour est le seul
remède contre la lassitude ascendante de ce monde
(« là, il contemple »
puis « las de contempler »)
où l’équilibre naturel est rompu. Mais
le corps humain est malade de cette rupture (le
« chaos du
corps » « a perdu son
point d’ancrage »). Rupture
qu’il a peut-être provoqué : le
remords est acéré
(« à ses rai-sons, à ses
re-mords ») comme les serres d’un faucon.
La perte de la femme aimée qui enchantait le monde provoque
un « silence assourdissant » et
symbolise pour lui la mort du monde : « la
mort porte son nom ». Il continue pourtant
à se raccrocher à ce souvenir de vie
même s’il en souffre :
« il saignera encore jusqu’à sa
mort ».
Love Song :
si l’amour est mort sur terre, il renaît dans
l’espace comme une complainte. Mais le chemin
« d’une vie à
l’autre » sera dur pour ceux qui se
rappellent la folie de leurs nuits passées
(« aux nuits
consumées »), pour ceux qui ont
préféré la compagnie
d’eux-mêmes à la folie du monde
(« aux solitaires ») et autres de
ce monde oublié qu’est la Terre. Cette
traversée de gel sidéral oblige l’homme
à faire l’expérience de ses limites
physiques : « pas un hiver qui ne
saigne ». Il doit vaincre les
« résistances » de son
corps face à ce monde
« dissonant »,
différent de celui qui l’a vu naître.
Comment y arriver ? La lumière de l’amour
qui porte de l’hypothèse de la mort vers
l’espoir de la vie comme une balançoire dans
l’espace. Se raccrocher sans cesse au son(g) de sa voix,
surtout si l’on fait partie des
« laissés pour
compte », qui n’ont pas
été choisis pour rejoindre un nouveau monde dans
un vaisseau trop étroit pour accueillir
l’humanité proliférante. Il y a un
risque : le trou noir qui détruit, ou
crée un passage vers une zone trop
éloignée d’un monde habitable
(« quand je vois l’ombre nous
séparer du monde »). Mais face
à l’oubli, un moment de grâce.
Privilège de l’errant sidéral, il peut
voir la lune de près danser pour lui :
« pâle est la lune, bal de
fortune ». On revoit les astronautes de Gravity
d’Alfonso Cuaron « dancing
alone » with « Sister
Moon » comme dirait Sting.
Pas d’access :
après sa balade astrale, l’homme perdu dans
l’espace a-t-il été fait prisonnier
d’un monde où jour et nuit se mêlent,
signe de sa perte de repères ? Il chante encore pour se
rappeler son humanité « pas de ce
monde ». Mais la douceur de la love song est devenue
l’ étrange ballade d’un être
à demi-privé de ses sens. Le sarcophage qui
accompagne le pharaon pour la pesée des âmes et
ici un couloir vers la déshumanisation. Le rappel du moment
de grâce face à la lune sur le titre
précédent rend plus urgente la
nécessité de la libération. Mais le
chemin n’est plus difficile, il est impossible. Les promesses
d’une autre planète où la vie serait
possible n’étaient que mensonges. Fuite dans la
folie ? Fuite dans la métempsychose
d’humain à faucon, le symbole du chasseur qui a la
liberté de l’oiseau et un lien profond avec
l’homme ? Fuite dans le désir
d’un retour sur Terre, là où
l’homme est né (« trouver son
nid ») en passant par une cathédrale, le
pont entre la terre et l’espace ? Echec du vol
salavateur : ce nouveau monde est comme une arme tranchante
pour l’homme (on entend « je
m’axe-phyxie »), à mi chemin
entre le volcan (« Kamtchatka »)
et le blizzard
(« Sibérie »). Cette
résurrection sous forme de faucon solaire, comme le pharaon
protégé par Horus, le dieu à
tête de faucon, dans les textes sacrés
égyptiens, était une fuite de prisonnier. Pas de
« ka », le double spirituel du
corps égyptien antique cf
« ca-thédrale »
« ka-mtchatka ». Comme pour Le
joueur d’échecs de Stefan Zweig, il
s’agissait d’une mise en scène psychique
divertissante mais dangereuse pour l’équilibre
(« obscures dérives, nuits
d’insomnie, lente agonie »). La
voilà qui revient pourtant d’elle-même
sans crier gare : « là je vole,
m’affole, moi faucon, je suis birdy » La
prison semble l’emporter dans le duel opposant
« il n’y a pas
d’access » à
« je suis birdy », traumatisme et
compulsion de répétition y compris dans la
scansion. Mais au dernier moment, dans un cri, le faucon
s’échappe. Un lien avec la Trilogie Nikopol
d’Enki Bilal ou le film Birdy d’Alan
Parker ?
I want you to want me :
cette pause, respiration, plénitude dans la voix permet un
retour en rêve à des considérations
terrestres et à des peurs plus quotidiennes et finalement
plus rassurantes : le désir que l’autre
éprouve les mêmes envies que soi. Besoin de
communion charnelle, spirituelle, affective, sentiment de manque,
présence-réconfort de l’être
aimé ou d’un ami. Se raccrocher aux mots
d’amour prononcés… Autant de sentiments
qui illuminent les objets et les petits gestes du quotidien :
acheter un vêtement pour plaire à son
aimé(e), décider de rentrer plus tôt du
travail…
Le faucon de Pas d’access aurait-il trouvé son
salut en se
lovant, voire en se nourrissant de la
Voie Lactée ?
L’extase de sa nouvelle liberté annihile toute
angoisse et pulsion de fuite, repli, suicide, rage, bruit. Elle
interdit de baisser les bras en créant une
évasion par le rêve et un viatique par la culture
comme l’a dit Victor Hugo. Cette
félicité permet d’affronter, de tenir
tête, presque de se moquer des phobies
expérimentées dans Pas d’access. Cette
victoire sur soi « longue vie aux morts de mes nuits
qui font la nique à l’ennui qui surgissent sans
répit » est un préalable
à l’expulsion de ces fantômes qui ont
assez géné l’envol :
« une part de moi qui s’en
va ». On retrouve alors la beauté de la
nature terrestre dans ce qu’on observe de l’espace.
La voie lactée n’est pas qu’un
éther éternel qui arrête le temps. Elle
est une neige « flocon
d’air » entre deux états et
deux saisons qui allie la beauté de l’hiver
à la renaissance du printemps. L’homme ou la
femme-faucon semble ici retrouver une voix d’enfant
à l’image du bébé
à la fin de 2001…
City of love :
la danse du faucon pris d’une illusion cotonneuse risque une
chute dans le réel de cendres. Mais pour l’heure,
il poursuit sa route et croise une cité idéale,
eden d’amour, récompense du chemin parcouru. Il
s’y plonge, « s’y
abandonne ». Il retrouve un peu l’usage de
la parole (« les mots au bout des
lèvres ») et en même temps son
humanité (« un chemin vers la
vie »). Il continue son rêve
d’enfant : « si je sais
que je l’ai et le monde et
l’envie » en écho à
« il est à moi, le
monde » de Dessine-moi un mouton. On peut aussi voir
dans cette City of love une image du bonheur que l’on
décide de construire pierre après pierre, avec
force et ferveur, avec l’autre. Cet autre ici, on
l’attend, peut-être parce que cette utopie spatiale
n’est qu’une projection de l’inconscient
et ne vaut pas l’amour sur terre de C’est pas moi.
Les deux chansons sont d’ailleurs en vis-à-vis sur
le livret. En tous cas, le faucon retrouve dans cette cité
ses contradictions d’homme (peur et courage, joie et
colère vont de pair), ses interrogations sur
l’espace infini, du trou noir de l’incertitude
à l’expérience, à
l’étude et à
l’émerveillement face à la neige
astrale de lune-hiver. Dans son rêve, il revient donc de
lui-même à son point de
départ : il n’a pas quitté la
voie lactée…
Un jour ou
l’autre signe le retour au réel du
faucon qui n’est qu’un homme perdu dans
l’univers : « tout
s’efface, un point dans
l’univers ». La prison, la cité
d’amour, la transformation en faucon, autant de projections
de son esprit en fonction des sensations dans cet espace tour
à tour menaçant, dangereux et sublime. On
retrouve le fantasme salvateur mais factice de Stolen car et le film
Interstellar de Christopher Nolan. Un homme seul, privé de
toute source (« eaux solitaires »
ou l’ « ocre, tout
ruisselle » = eau de Mars ?) et de toute
trace de vie, privé de l’autre, de son
identité. Fragile humanité qui rappelle la
chanson Fragile de Sting : nous sommes fragiles ici, nous le
sommes encore plus là-bas. Le mirage spatial est un
labyrinthe qui nous dépasse (« combien de
vie se perdent en chemin »).
L’enthousiasme de la conquête spatiale
s’est révélé vain, au
détriment de l’essentiel, la vie et
l’amour sur terre : « nous irons
aussi loin, nous prendrons le temps de nous ».
Sursaut de l’âme tardif, nous aurions pu nous
contenter de ce que nous avions, il est trop tard
(« pluie de fous »). Le
rêve-mensonge (« illusions à
genoux ») au-delà de toute raison
(« consciences endormies »)
condamne l’humanité à
disparaître : « l’absence
et puis l’oubli ». Viennent les regrets
sur ce qu’il aurait fallu faire sur Terre :
l’amour de ses proches, l’amour des
éléments (eau, air), respecter le ciel qui nous
protège du feu asphyxiant de l’espace et pourquoi
pas plutôt s’élever pour tenter de le
recoudre ? Mais le ciel s’est
résigné. L’homme est capable de
merveilles (« des peintres de
lumières ») comme d’organiser
son propre trépas (« noirs
mélanges ») et
hypothétiquement le retour vers son créateur
(« si c’est au nom du
père »). Cette métaphysique
tourne à vide dans l’esprit de cet homme perdu
dans l’espace, car trop tardive (« des
questions sans réponse »), tentation du
renoncement : les océans d’illusions de
jadis sont à genoux. En note finale pourtant, la voix de
Mylène revient sur l’espoir incertain mais bien
présent de retrouver une étoile, une terre aussi
belle et bonne que la nôtre. Nous souviendrons nous ?
Triste fin ? Tout dépend de ce que nous en feront
car, comme le rappelle la snare militaire du titre, il n’y a
pas d’ailleurs…

 Les dernières news
Les dernières news Les news les plus lues
Les news les plus lues